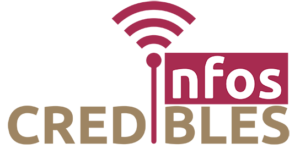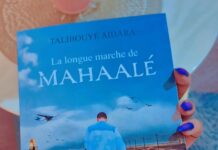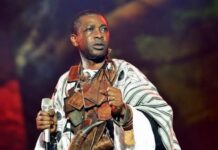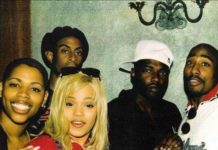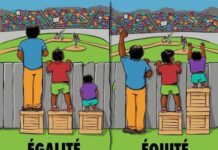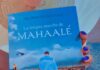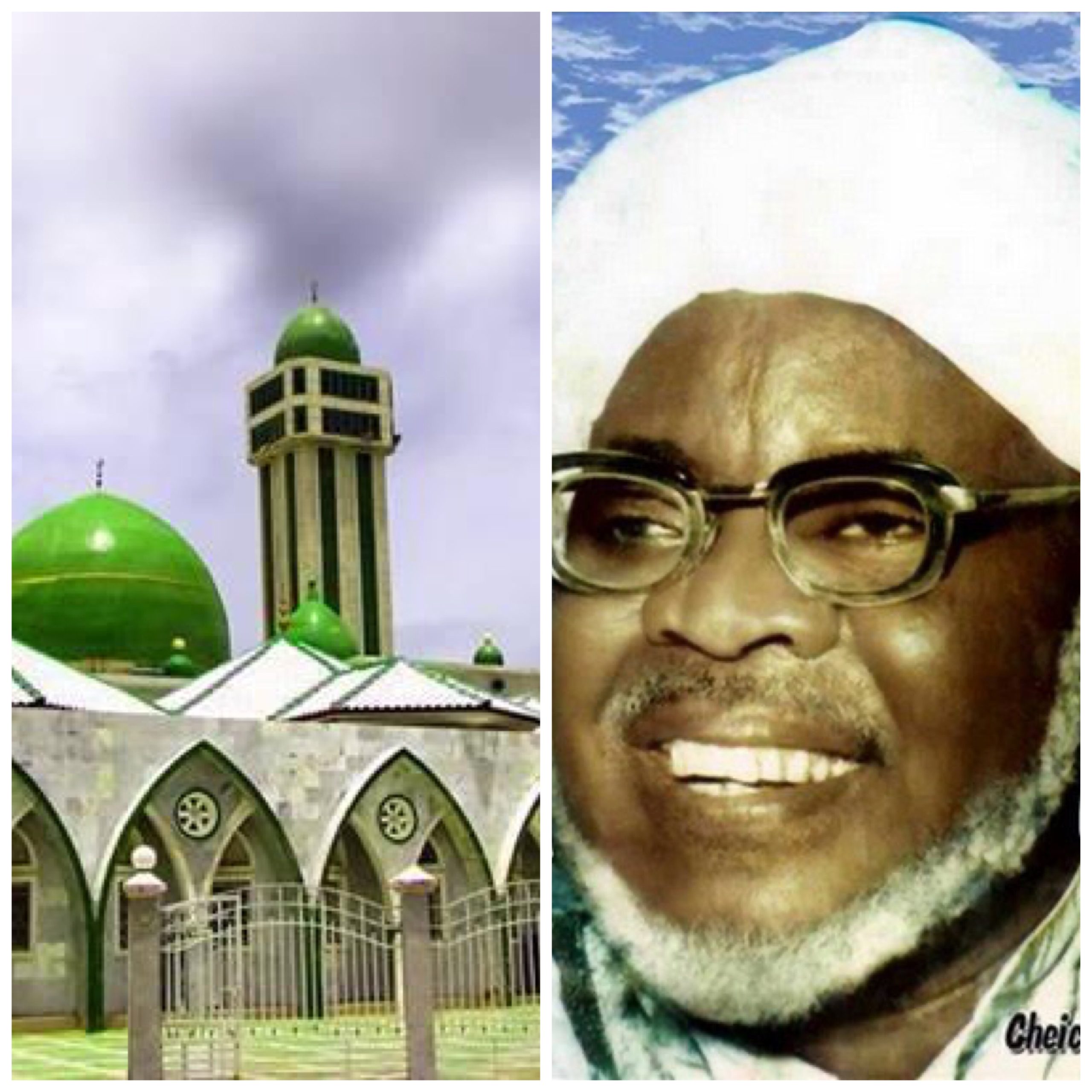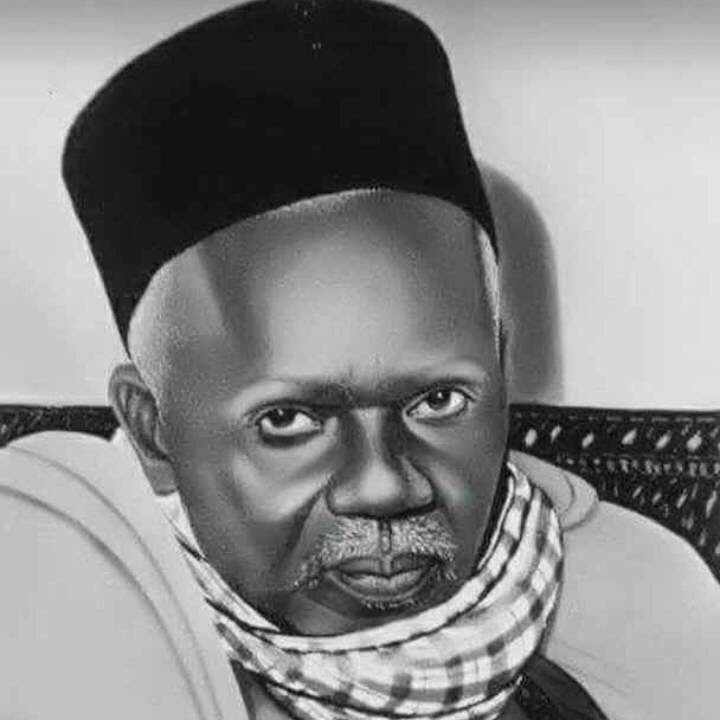Le sommet du G20 qui s’est tenu à Johannesburg les 22 et 23 novembre 2025 a marqué un tournant historique pour l’Afrique. Pour la première fois, le continent accueillait la réunion annuelle des principales économies mondiales, offrant une opportunité unique de peser sur les grandes décisions économiques internationales. Au cœur des débats figuraient la dette souveraine, le financement du développement et la transition énergétique, ainsi que la nécessité de réformes structurelles des institutions financières mondiales. La présence de l’Union africaine et la mobilisation d’experts tels que l’économiste sénégalais Daouda Sembene ont permis de porter la voix du continent sur la scène mondiale avec précision et force.
Les données macroéconomiques présentées au sommet révèlent la gravité des enjeux. Selon le rapport World economic siuation and prospects 2025 des Nations Unies, le ratio moyen dette publique/PIB en Afrique est passé de 68,9 % en 2023 à 67,5 % en 2024 et devrait atteindre 64,3 % en 2025. Le stock de la dette extérieure africaine s’élève à environ 1 150 milliards de dollars, et le coût du service de cette dette a représenté en 2024 près de 163 milliards de dollars, soit une part significative des recettes publiques pour plusieurs pays. Dans certains États, comme le Nigeria, le Ghana ou le Kenya, les paiements d’intérêts peuvent absorber jusqu’à 70 % des revenus fiscaux, limitant fortement la capacité d’investissement social et infrastructurel. Cette situation illustre la pression persistante exercée par les marchés financiers internationaux et souligne la nécessité de mécanismes de refinancement innovants et équitables.
Daouda Sembene, membre du panel d’experts africains, a rappelé lors d’une intervention à France 24 que le sommet constituait «un moment de bascule» pour le continent. Il a plaidé pour la création d’un mécanisme multilatéral de refinancement capable de réduire les coûts d’emprunt, d’allonger les maturités et de restaurer la confiance des investisseurs, tout en corrigeant les biais dans la perception du risque africain. Pour Sembene, l’Afrique ne doit plus être perçue comme un simple bénéficiaire de mesures de secours, mais comme un acteur capable d’influencer durablement la structure financière mondiale. Ses analyses, soutenues par des données rigoureuses sur le coût du service de la dette et sur les conditions d’emprunt, ont trouvé un écho auprès des ministres africains et de plusieurs institutions financières internationales.
Dans son discours lors de la séance plénière, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné l’importance symbolique et politique de ce sommet. Il a appelé à un rééquilibrage du système financier international, dénonçant une «inégalité d’accès au financement» qui handicape les nations vulnérables et limite la croissance durable. Cyril Ramaphosa a insisté sur la nécessité d’alléger le fardeau de la dette, d’accroître les financements climatiques et de renforcer les institutions africaines de développement, notamment le Fonds africain de développement. Selon lui, le continent doit disposer de ressources propres pour investir dans les infrastructures, l’énergie renouvelable et l’adaptation climatique, afin de réduire sa dépendance à l’égard des financements extérieurs.
Les questions climatiques et énergétiques ont également occupé une place centrale dans les discussions. L’Afrique, qui subit de plein fouet les conséquences du réchauffement global malgré sa faible contribution aux émissions mondiales, réclame un accès simplifié aux financements d’adaptation et une coopération renforcée pour sa transition énergétique. Les délégations des États-Unis, de l’Union européenne, de la Chine et de l’Inde ont exprimé leur engagement à soutenir cette transition, tout en rappelant la nécessité de partenariats stratégiques et d’une gestion transparente des ressources. L’attention portée aux minéraux critiques a illustré le rôle stratégique que l’Afrique peut jouer dans la transition énergétique mondiale, non plus comme simple fournisseur de matières premières mais comme acteur central de chaînes de valeur locales et d’industries durables.
Les implications macroéconomiques sont significatives avec la mise en place d’un mécanisme de refinancement pourrait réduire le coût du service de la dette, libérant des ressources pour l’investissement social et productif. Le renforcement du Fonds africain de développement permettrait de mobiliser davantage de capitaux locaux et internationaux pour des projets structurants, mais cette perspective dépend de la crédibilité des engagements internationaux et de la gouvernance efficace des fonds. Le G20 de Johannesburg a ainsi posé les bases d’un rééquilibrage partiel mais essentiel du système financier mondial, en donnant à l’Afrique une capacité d’influence jusque-là inédite.
Le sommet a révélé que la voix du continent, portée par des leaders comme Cyril Ramaphosa et des experts comme Daouda Sembene, pouvait désormais structurer la discussion internationale. Les décisions prises et les engagements formalisés traduisent un mouvement vers un ordre économique plus inclusif et plus équitable, dans lequel l’Afrique n’est plus simplement spectatrice mais acteur stratégique. Si les mécanismes proposés sont mis en œuvre avec rigueur et transparence, Johannesburg pourrait être le point de départ d’une nouvelle ère, où la croissance, le financement durable et la transition énergétique en Afrique seront intégrés aux grandes décisions économiques mondiales. Zaynab Sangarè