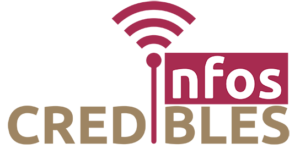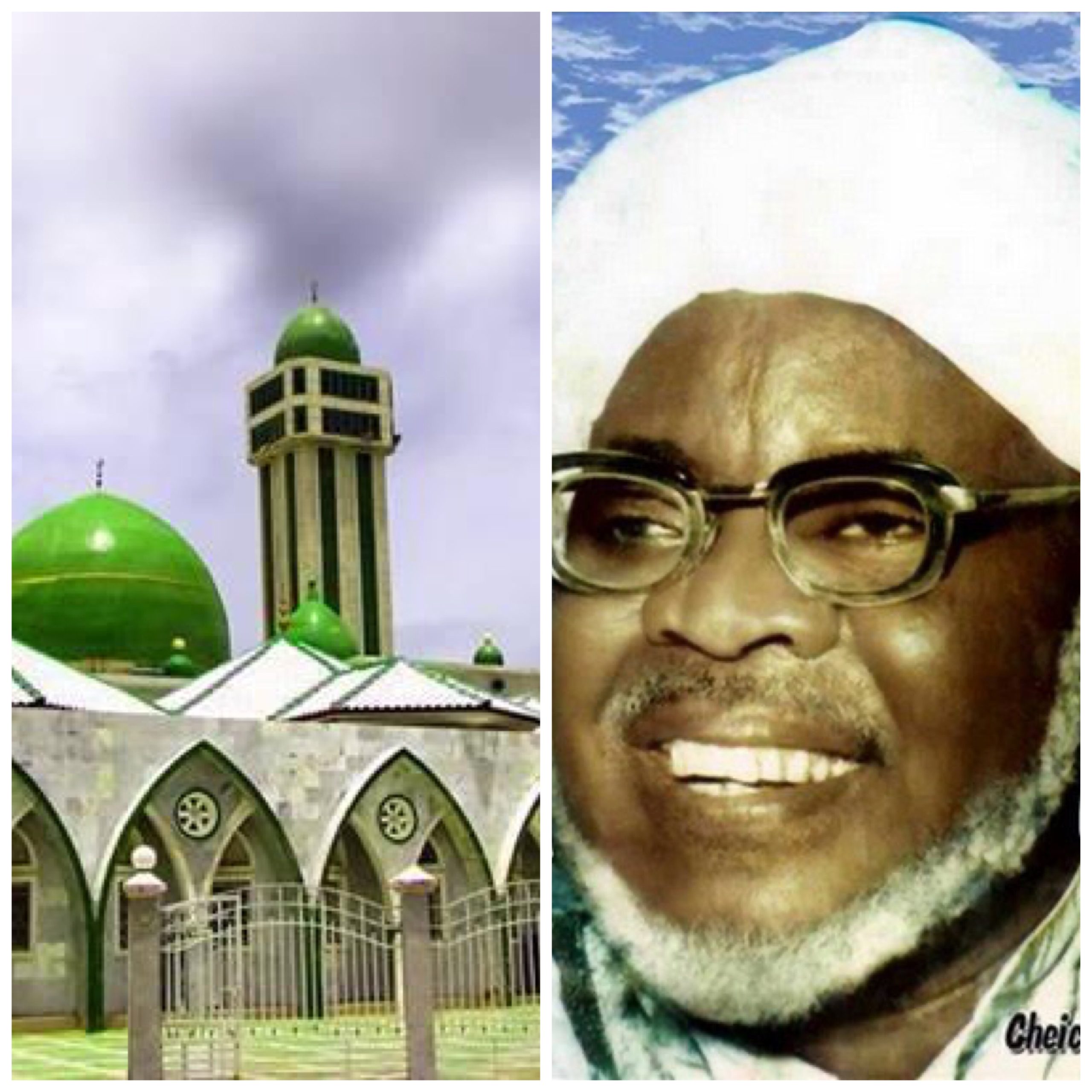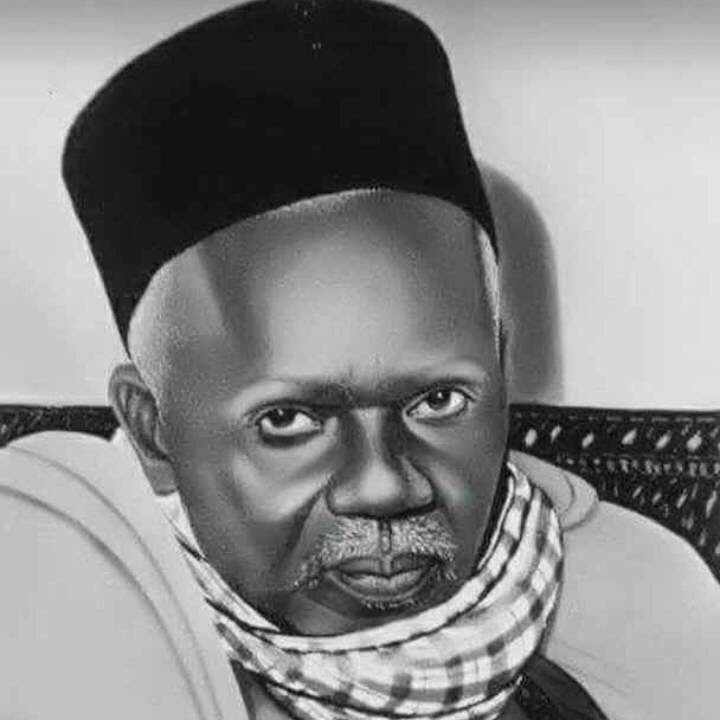Dakar accueille cette semaine, sous la bannière de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), une mission d’assistance technique consacrée à la modernisation de son système d’information aéronautique. L’enjeu est de taille, s’agissant pour le Sénégal de basculer du Service d’Information Aéronautique (AIS), hérité des standards des années 1960, vers la Gestion de l’Information Aéronautique (AIM), une approche numérique et structurée censée garantir la qualité, la précision et la disponibilité instantanée des données critiques pour la navigation aérienne. Mais derrière les discours officiels et les photographies de courtoisie, se pose la question de la faisabilité réelle et de la capacité technique nationale à honorer cet engagement stratégique.
Selon les normes de l’OACI, cette transition devrait être achevée pour tous les États membres depuis 2020. Or, dans la région AFI (Afrique–Océan Indien), seule une poignée de pays, dont l’Afrique du Sud et le Kenya, ont effectivement mis en œuvre des systèmes AIM opérationnels conformes. Un rapport d’évaluation technique du Bureau Afrique-Océan Indien de l’OACI, publié en 2023, relevait que 72 % des États de la région ne disposaient pas encore d’un plan national AIM abouti, et que 64 % d’entre eux n’avaient pas entamé la phase critique de migration numérique des données. Le Sénégal figure parmi ces États en retard.
La mission RBIS qui se tient à Dakar du 22 au 25 avril 2025 est donc stratégique. Elle intervient dans un contexte où les incidents liés à la qualité ou à l’obsolescence des données aéronautiques restent préoccupants. Un rapport de l’ASECNA en 2022 faisait état de 57 notifications de divergences d’informations publiées dans les NOTAM (avis aux navigants aériens) pour la seule zone d’information de Dakar, représentant une augmentation de 35 % par rapport à 2020. Ces incohérences, qui peuvent concerner des données de coordonnées géographiques, d’altitude minimale de sécurité ou d’informations sur des obstacles, sont reconnues comme des facteurs de risque avérés pour la sécurité des opérations aériennes.
Officiellement, le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a affirmé que l’implication de toutes les parties prenantes – AIBD SA, LAS, ASECNA, ANAT – devrait permettre de transformer cette mission en « actions concrètes et durables ». Mais l’enjeu ne se limite pas à la volonté institutionnelle. Selon les données du rapport de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) de 2024, le Sénégal consacre seulement 0,9 % de son budget aéronautique annuel à la modernisation des infrastructures AIM, bien en deçà de la moyenne régionale qui se situe à 2,7 %. Ce sous-investissement chronique freine l’acquisition de solutions logicielles, la formation de personnels spécialisés et l’intégration des systèmes de données interconnectés requis.
Autre défi, l’interopérabilité des données aéronautiques avec les systèmes voisins. À ce jour, aucune plateforme de partage numérique de données n’existe entre le Sénégal et ses États limitrophes pour garantir une mise à jour harmonisée des informations en temps réel, comme le préconise pourtant le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l’OACI. Une lacune qui fragilise la gestion du trafic aérien régional, alors que le nombre de mouvements d’aéronefs dans la FIR (région d’information de vol) de Dakar a bondi de 18 % entre 2019 et 2023, selon les statistiques de l’OACI.
Si cette mission d’assistance technique se veut porteuse d’espoir, elle met également en avant les écarts persistants entre les standards internationaux et les capacités effectives des États africains. Le Sénégal joue ici une partie essentielle de sa crédibilité technique et de sa souveraineté aérienne régionale. Car dans un ciel de plus en plus dense et interconnecté, l’information aéronautique n’est pas un luxe administratif, mais une donnée vitale. Zaynab Sangarè