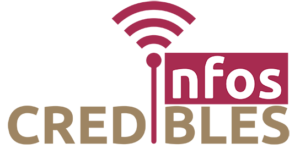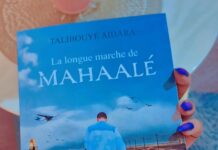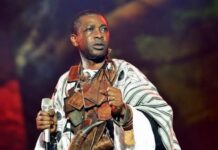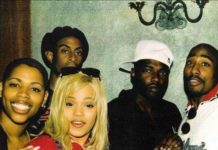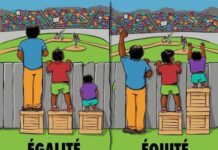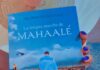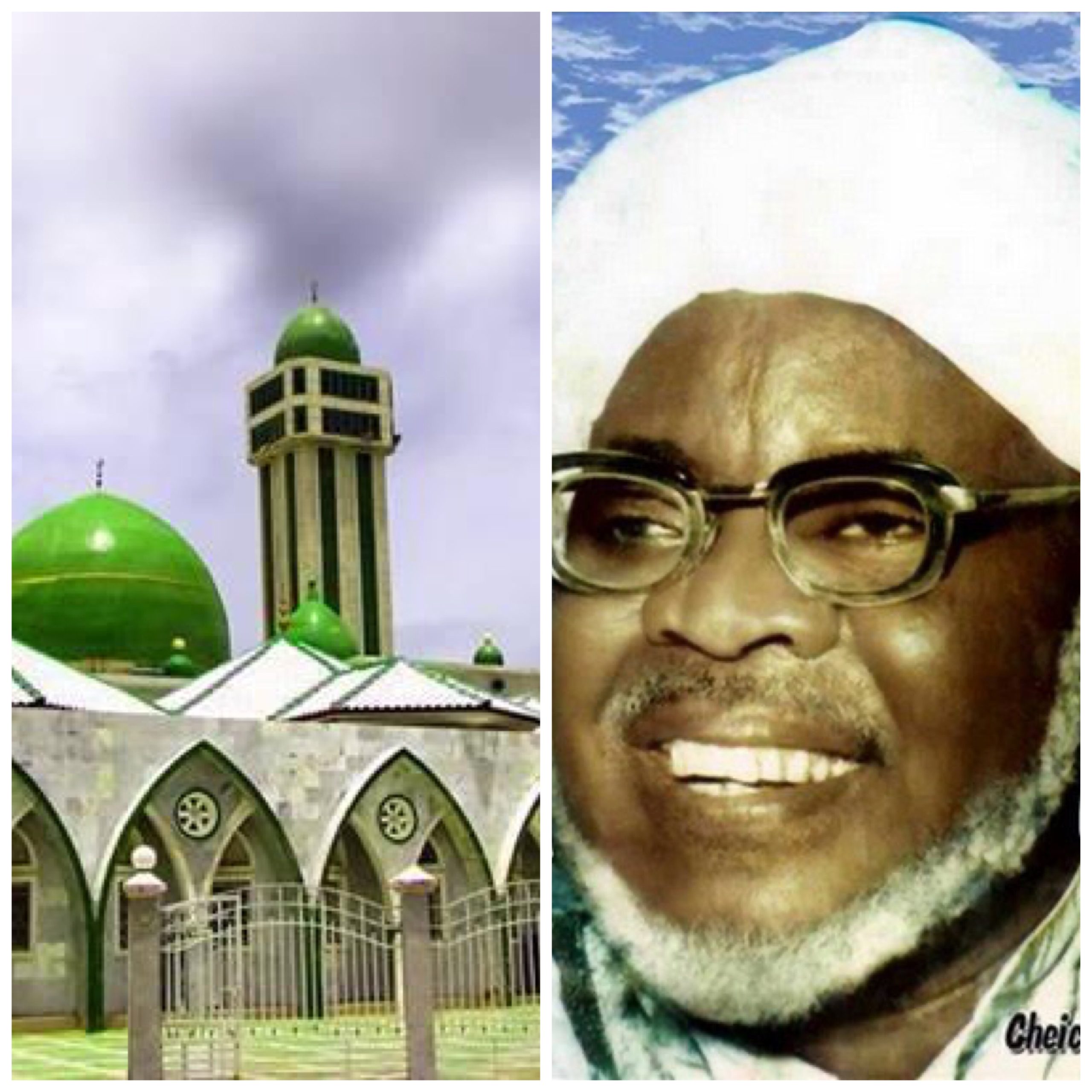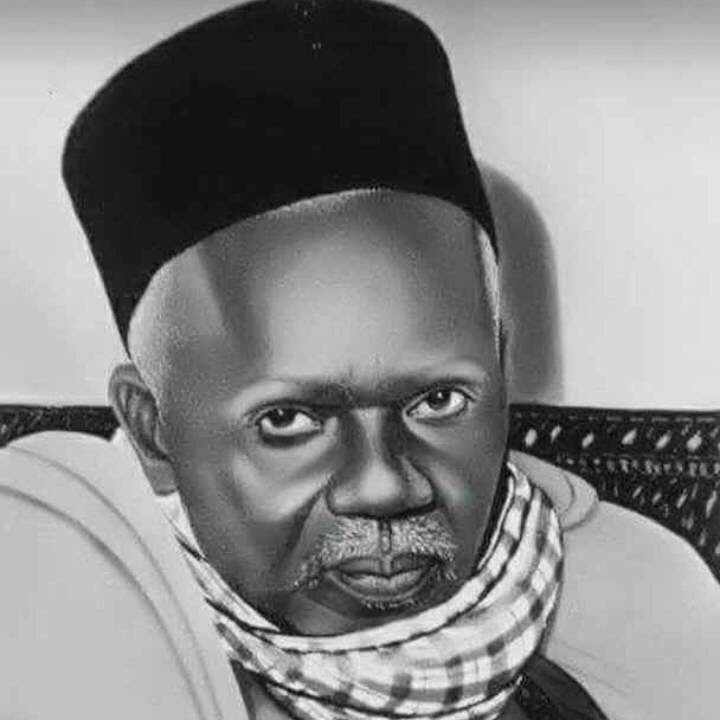À quelques semaines de la COP30 au Brésil, une étude d’envergure menée par l’ONG Global Witness et le cabinet de conseil néerlandais Profundo démontrent une contradiction majeure dans la lutte contre la déforestation, alors que les gouvernements mondiaux, réunis dans le cadre de l’Accord de Paris, s’efforcent de mobiliser des financements pour préserver les forêts tropicales, les principales institutions financières internationales continuent de tirer des bénéfices considérables du financement d’entreprises responsables de la destruction de ces écosystèmes essentiels.
Selon cette nouvelle enquête, les banques et gestionnaires d’actifs ont généré 26 milliards de dollars de revenus entre 2016 et 2024 en soutenant financièrement 50 entreprises identifiées comme impliquées dans la déforestation. Ces profits proviennent d’un éventail d’activités allant des prêts et émissions d’obligations jusqu’aux investissements en actions. Si les États-Unis arrivent en tête avec 5,42 milliards de dollars de revenus, l’Indonésie, pays fortement exposé à la déforestation, occupe la deuxième place (4,94 milliards de dollars), devant le Brésil (2,12 milliards), le Japon (2,02 milliards) et plusieurs États membres de l’Union européenne.
Ce phénomène met en cause de grandes institutions comme Vanguard, BlackRock, JPMorgan Chase, BNP Paribas, Rabobank, HSBC ou encore la banque de développement brésilienne BNDES. Ces acteurs, bien que souvent engagés publiquement en faveur de la durabilité, continuent à financer des entreprises actives dans des secteurs à fort impact environnemental, notamment la pâte à papier, l’huile de palme, le soja, l’élevage bovin, le caoutchouc et le bois. Les seuls secteurs de la pâte à papier et de l’huile de palme représentent ensemble 89 % des revenus issus du financement des entreprises à risque.
Linda Rosalina, directrice exécutive de l’ONG TuK INDONESIA, souligne la responsabilité conjointe des institutions locales et des capitaux étrangers. Selon elle, les banques indonésiennes, fortement investies dans les secteurs de l’huile de palme et du papier, répondent à une logique de rentabilité à court terme soutenue par des investisseurs internationaux. Ce déséquilibre structurel est confirmé par l’ampleur des besoins en capital de ces industries, qui nécessitent souvent plusieurs dizaines de millions de dollars d’investissement initial par projet.
La concentration des profits ne reflète cependant pas nécessairement le volume réel de la déforestation. Si la pâte à papier et le papier sont les secteurs les plus rentables pour les banques, d’autres chaînes d’approvisionnement, comme le bœuf et le soja, sont reconnues par la communauté scientifique comme les premiers moteurs de la perte de forêts tropicales. Une étude évaluée par des pairs en 2022 a ainsi estimé que ces deux matières premières, avec l’huile de palme, étaient responsables de plus de la moitié de la déforestation tropicale entre 2011 et 2025.
La cartographie établie par Global Witness repose sur une base de données exhaustive (Forests & Finance), couvrant près de 184 milliards de dollars de transactions financières avec des entreprises à risque. Elle inclut notamment des prêts, des commissions d’émission et des investissements en actions et obligations, et révèle l’implication de près de 4 000 institutions financières à travers le monde. En comparaison, les 26 milliards de dollars générés sur cette période représentent plus du double des dépenses consacrées par le Royaume-Uni à la lutte contre le changement climatique entre 2011 et 2021.
Certaines institutions contestent néanmoins la méthodologie utilisée. BNP Paribas, par exemple, a rejeté les conclusions de l’étude et affirme s’engager fermement en faveur de la biodiversité et de la lutte contre la déforestation. De son côté, la BNDES a réfuté tout lien direct entre ses financements et des actes de déforestation, tout en reconnaissant avoir renforcé ses mécanismes de contrôle dans ce domaine. HSBC, également épinglée pour son rôle dans des projets au Paraguay, n’a pas souhaité répondre aux questions de Global Witness.
Ces données arrivent à un moment stratégique, alors que le gouvernement brésilien s’apprête à lancer le Fonds pour les forêts tropicales éternelles (TFFF) lors de la COP30. Ce mécanisme vise à canaliser les flux financiers mondiaux vers la préservation des forêts, en générant des bénéfices réinvestis dans les pays forestiers. Toutefois, comme le souligne Nicola Ranger, professeure à la London School of Economics, il est illusoire de croire que l’on peut accroître le financement de la protection de la nature sans s’attaquer simultanément aux flux financiers qui alimentent sa destruction. Actuellement, à peine 200 milliards de dollars sont investis chaque année dans des projets favorables à la nature, alors que plus de 7 000 milliards alimentent des activités environnementalement destructrices.
L’étude insiste enfin sur le fait que les profits générés par les institutions financières sont souvent concentrés dans un petit nombre d’acteurs et de chaînes de valeur. Par exemple, la Bank Central Asia, en Indonésie, est la première bénéficiaire mondiale avec 1,1 milliard de dollars de revenus, suivie par la BNDES (868 millions) et Suzano, le géant brésilien de la pâte à papier, dont les activités suscitent des critiques croissantes quant à leur impact social et écologique.
En l’absence de régulation efficace et contraignante du financement des entreprises liées à la déforestation, ces chiffres confirment la difficulté de concilier les objectifs climatiques avec les dynamiques de marché. À l’approche de la COP30, le contraste entre les engagements internationaux et les pratiques du secteur financier reste un enjeu central pour toute stratégie de lutte contre la déforestation et de transition écologique durable.