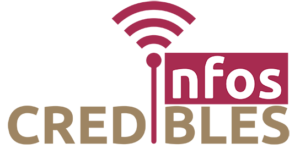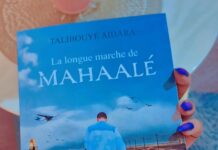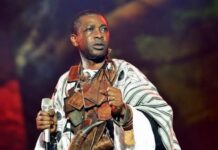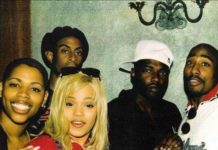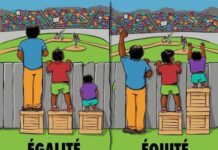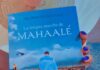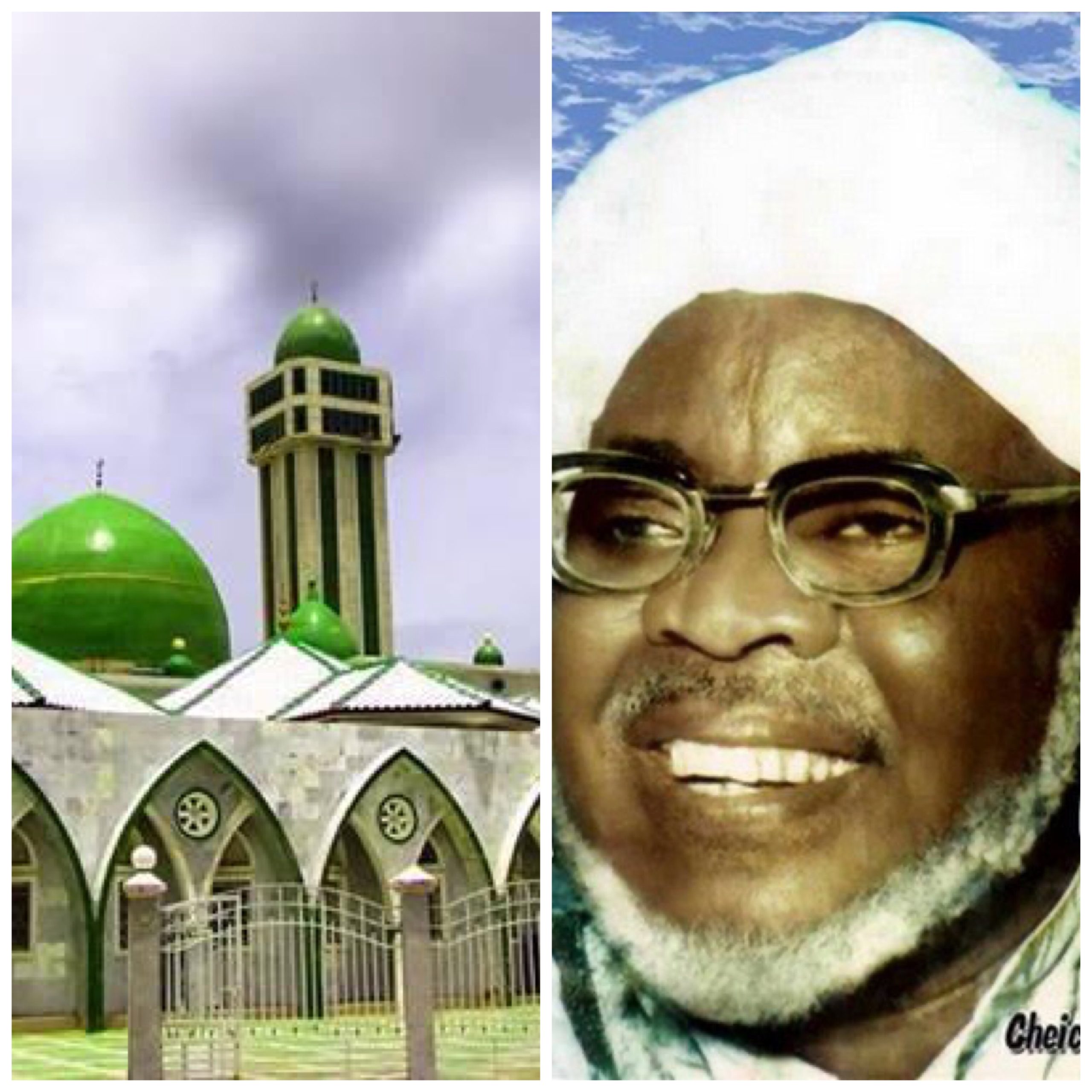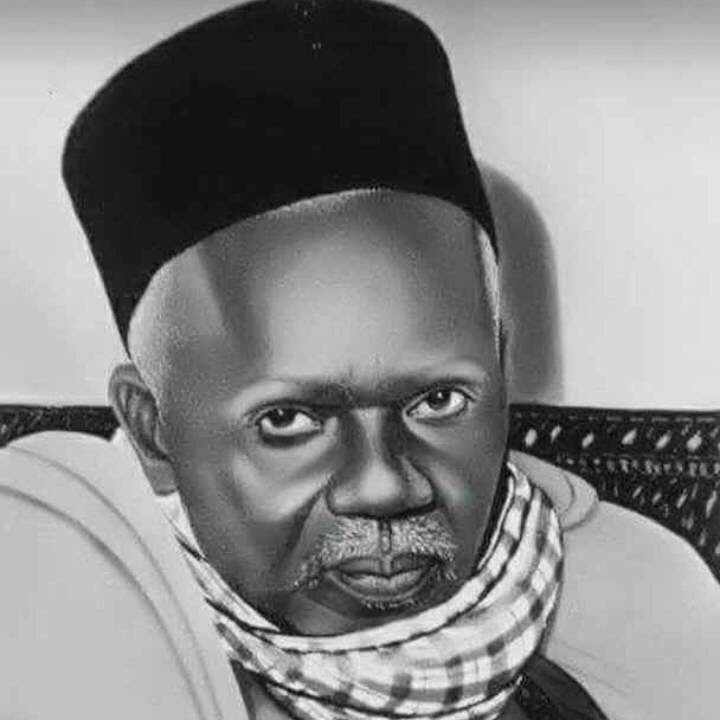Dans la perspective du 7ᵉ sommet Union européenne – Union africaine qui se tient à Luanda les 24 et 25 novembre 2025, se dessine un plan économique ambitieux avec plus qu’une commémoration du quart de siècle de partenariat, l’UE et l’UA se donnent les moyens de traduire leur vision commune en investissements concrets, alignés sur des priorités structurelles stratégiques. Ce sommet, placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité par un multilatéralisme efficace », est soutenu par une roadmap financière portée notamment par le programme Global Gateway, déjà central dans les annonces européennes. Selon le conseil européen, l’UE s’est engagée à mobiliser au moins 150 milliards d’euros pour des projets en Afrique, afin d’accélérer la transition verte, la transformation numérique, les infrastructures et le développement humain.
Le volet paix et sécurité n’est pas en reste avec le mécanisme de la Facilité européenne pour la paix (European Peace Facility, EPF), déjà en action depuis plusieurs années, continue d’être alimenté et orienté vers des opérations africaines, avec un soutien accru à la prévention des conflits, au renforcement des capacités de maintien de la paix dirigées par l’Afrique, et à la gouvernance. Selon les informations de l’EEAS, plus de 600 millions d’euros ont été alloués à la Commission de l’UA entre 2022 et 2025 via l’EPF, tandis qu’une part importante de l’aide de l’EPF est consacrée à des missions africaines.
Parmi les scénarios économiques optimistes du sommet, figure la mobilisation complète des 150 milliards d’euros du Global Gateway. Dans cette hypothèse, les fonds pourraient dynamiser plusieurs secteurs importants. D’abord l’énergie avec le soutien porterait sur des infrastructures d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité) visant à renforcer l’accès à l’électricité, à développer des chaînes de valeur locales propres, et à créer un grand nombre d’emplois verts. Ensuite les transports avec un mécanisme d’accélération des corridors de transport, notamment ferroviaire, pourrait s’appuyer sur ces financements pour moderniser des axes stratégiques. Le corridor de Lobito en Angola, par exemple, est particulièrement stratégique qui pourrait relier des zones minières (cuivre, cobalt) à l’Atlantique, ce qui permettrait non seulement de décongestionner le transport, mais aussi d’augmenter la transformation locale des ressources naturelles, renforçant ainsi l’industrialisation. Cette proposition trouve un écho dans des analyses géostratégiques autour du développement ferroviaire angolais.
Le Business Forum UE‑UA (AEBF 2025), organisé parallèlement au sommet, joue un rôle pivot dans la matérialisation de ces ambitions. Il réunit dirigeants d’entreprise, investisseurs, innovateurs et décideurs publics pour identifier des projets «bankables» et stimuler les partenariats public-privé. Le forum doit faciliter le déploiement de solutions de financement innovantes dans des secteurs comme le numérique, les infrastructures durables, l’éducation et la santé.
Des scénarios plus ambitieux, au-delà des 150 milliards initiaux, sont également envisagés. En effet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a récemment déclaré que l’UE vise à mobiliser plus de 400 milliards d’euros d’ici 2027 via Global Gateway, étendant les ambitions d’investissement vers des partenariats stratégiques et en sécurisation de matières premières critiques. Si ce scénario se concrétise, il pourrait révolutionner l’échelle du développement en Afrique, non seulement par les infrastructures, mais aussi par des initiatives industrielles fortes, l’innovation technologique et des chaînes de valeur locales dans les domaines stratégiques.
Cependant, l’optimisme doit être nuancé par des risques concrets. La capacité des États africains à absorber ces investissements dépend fortement de leur stabilité politique, de la transparence dans la gouvernance et de la qualité réglementaire. Si des retards dans la mise en œuvre des projets ou des failles dans la gestion des fonds se manifestent, les résultats pourraient être bien en deçà des promesses. Le secteur privé européen, bien que prêt à s’engager, exige des garanties crédibles, sans des mécanismes robustes de suivi et des conditions claires, certains investissements à forte valeur ajoutée pourraient ne jamais voir le jour.
Un autre risque provient de la dimension géopolitique avec les grands projets, comme le corridor de Lobito, attirent des concurrents internationaux. Si l’Europe parvient à aligner ses investissements sur une vision industrielle durable et locale, les retombées pourraient bénéficier à l’Angola et à ses voisins. Mais dans le cas contraire, ces infrastructures pourraient servir principalement à l’exportation de matières premières, limitant les gains de développement local.
Les conditions macroéconomiques mondiales représentent une autre menace. Une baisse de l’engagement européen, liée à des défis économiques internes, ou une hausse des taux d’intérêt pourrait freiner la mobilisation des fonds annoncés. En parallèle, les pays africains pourraient voir s’éroder leur capacité d’absorption par des pressions inflationnistes, une instabilité monétaire ou des événements climatiques catastrophiques. L’impact des catastrophes naturelles doit aussi être pris en compte avec des sécheresses ou des inondations pourraient affecter des infrastructures récemment financées, compromettant leur rentabilité et leur durabilité.
Sur le plan social, les risques d’inégalité sont palpables. Si les investissements ne sont pas accompagnés de politiques inclusives, la jeunesse africaine, aujourd’hui très nombreuse pourrait ne pas bénéficier proportionnellement des retombées. Le forum de la société civile et de la jeunesse de l’UA‑UE, organisé juste avant le sommet, met d’ailleurs l’accent sur la nécessité que leurs voix soient prises en compte dans l’orientation des politiques de coopération.
Institutionnellement, le succès de ces scénarios dépendra de la capacité à traduire les engagements diplomatiques en action concrète. Une gouvernance transparente, un suivi rigoureux, des mécanismes de responsabilisation et la co-construction de projets entre l’Afrique et l’Europe sont essentiels. Si ces conditions sont réunies, le sommet de Luanda pourrait marquer le passage d’un modèle fondé sur l’aide à un véritable partenariat stratégique, avec des investissements durables, une infrastructure modernisée, une intégration économique renforcée, et une montée en compétences des populations locales.
Ainsi, à l’issue de ces deux jours de sommet, les projections économiques dessinent un panorama à la fois ambitieux et réaliste : l’UE et l’UA pourraient concrétiser des projets hors norme, créer des chaînes de valeur industrielles, stimuler l’innovation et renforcer la souveraineté économique africaine. Mais l’équilibre entre espoir et prudence sera déterminant sur le défi ne sera pas seulement de promettre, mais de réaliser. Le 7ᵉ sommet UE‑UA pourrait bien être le moment où les mots laissent place aux actes, à condition que tous les acteurs s’engagent pleinement dans la mise en œuvre de cette vision partagée. Zaynab Sangarè