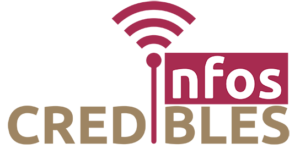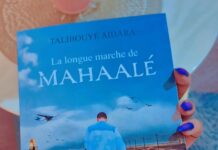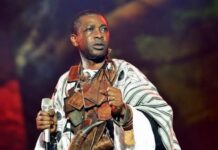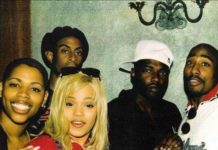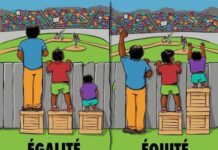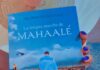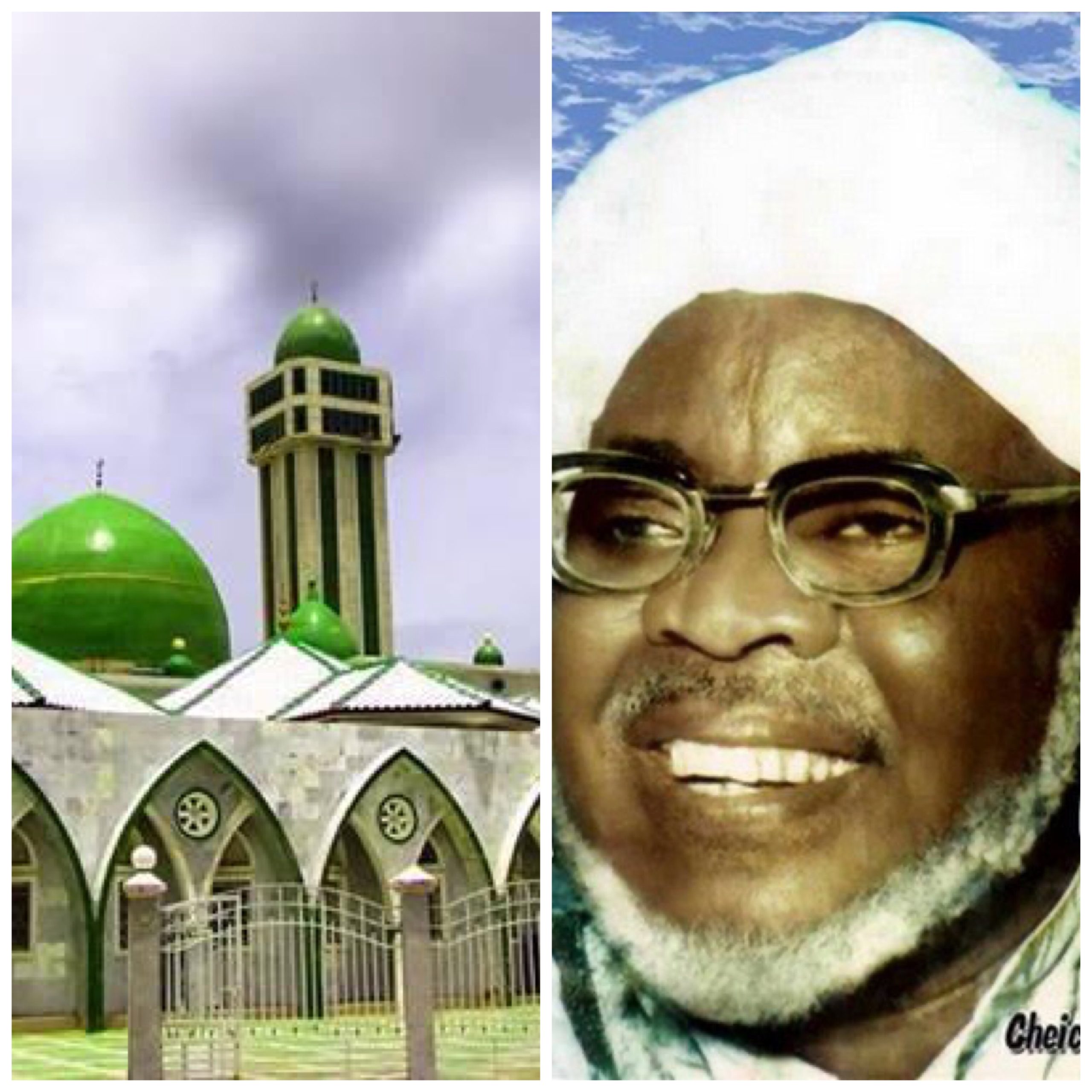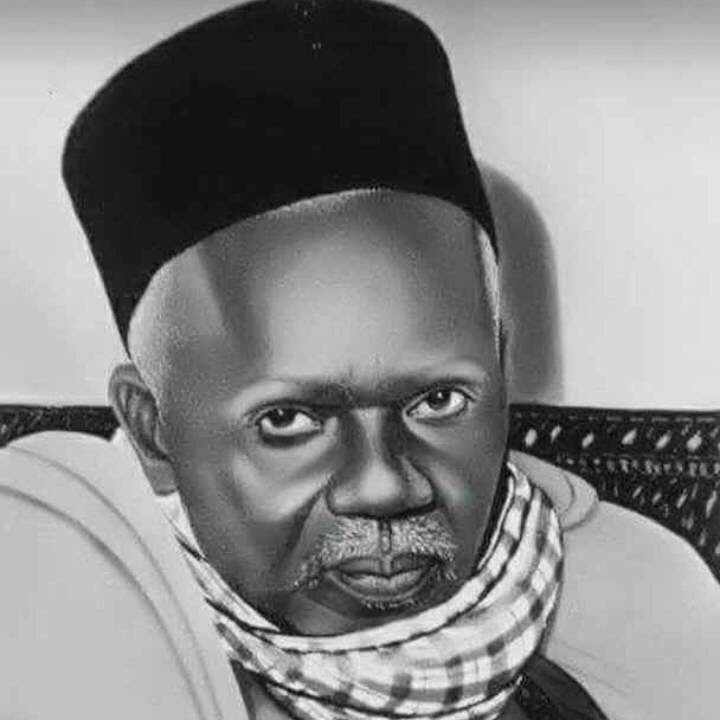Le paludisme, maladie parasitaire ancienne mais toujours redoutable, demeure l’une des principales causes de mortalité en Afrique. Chaque année, avec l’arrivée de la saison des pluies, le risque de flambées épidémiques resurgit, particulièrement dans des pays comme le Burkina Faso. Pourtant, les efforts déployés depuis deux décennies commencent à porter leurs fruits : entre 2000 et 2020, les décès liés au paludisme ont baissé de 57 % sur l’ensemble du continent, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Malgré ces progrès, la lutte contre cette maladie reste une priorité de santé publique. Au Burkina Faso, la stratégie de chimioprévention saisonnière a permis de sauver de nombreuses vies, notamment parmi les enfants, les plus vulnérables face au parasite.
« Nous associons à la chimioprévention la détection de la malnutrition au niveau communautaire, la destruction des gîtes larvaires, et le suivi vaccinal des enfants », explique le Dr Sidzabda Kompaoré, secrétaire permanent pour l’élimination du paludisme au Burkina Faso.
Cette approche intégrée, combinant prévention, traitement précoce, éducation communautaire et actions environnementales, renforce l’impact des interventions sanitaires. L’objectif est clair : atteindre une baisse de 90 % des cas et des décès d’ici 2030, comme le prévoit la stratégie mondiale contre le paludisme de l’OMS.
« Nous sommes déterminés à fournir tout le soutien technique et financier nécessaire pour permettre au ministère de la Santé de déployer ses stratégies sur le terrain », affirme le Dr Clotaire Hien, représentant de l’OMS au Burkina Faso.
Malgré les avancées, le paludisme continue de faire près de 400 000 victimes par an sur le continent africain. Les efforts doivent donc se poursuivre, avec une attention particulière portée à la résistance croissante aux traitements et à l’émergence de nouveaux vecteurs plus difficiles à contrôler.
Alors que la recherche progresse sur les vaccins et les nouvelles approches thérapeutiques, les acteurs de la santé publique insistent sur un impératif : maintenir une mobilisation constante, ancrée dans les réalités locales et soutenue par des ressources durables.