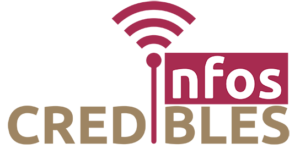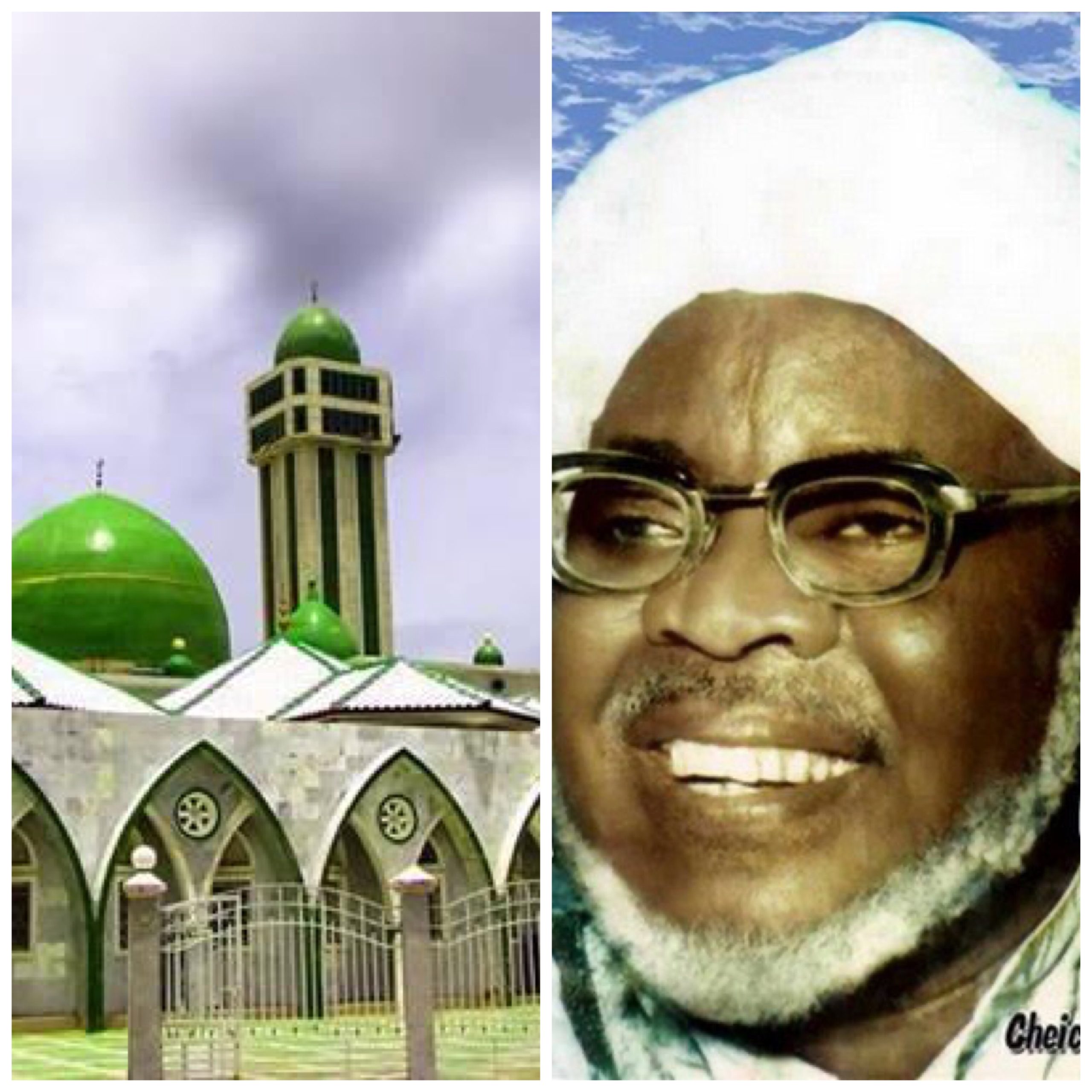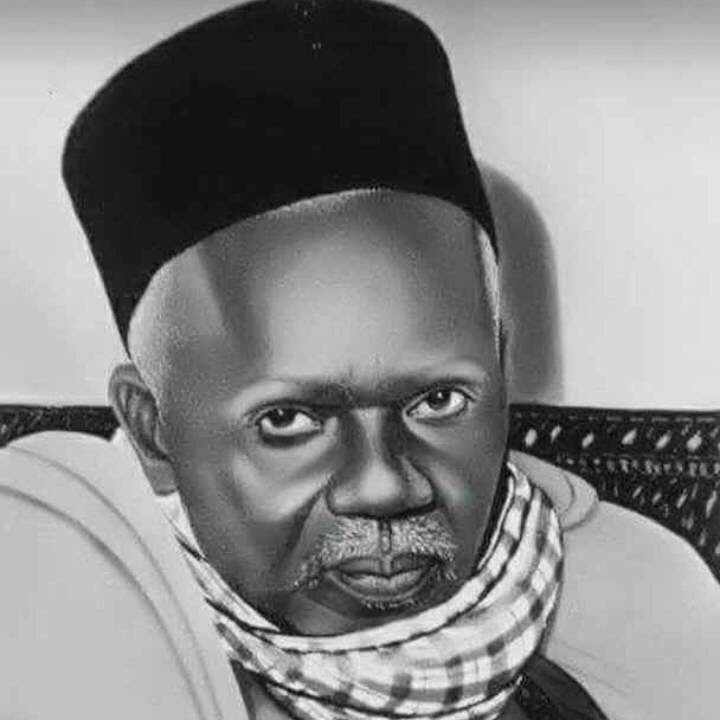Dans un contexte economique obscure, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie a publié aujourd’hui les nouveaux comptes nationaux du Sénégal, désormais établis sur l’année de base 2021. Cette mise à jour marque un tournant majeur dans l’analyse de l’économie nationale, car jusqu’ici toutes les évaluations s’appuyaient encore sur la base de 2014. Les transformations structurelles, la digitalisation progressive de l’administration, l’explosion du secteur informel et les mutations dans l’industrie rendaient indispensable un rebasage. Les résultats publiés révèlent non seulement une économie plus vaste que précédemment estimée, mais aussi des répercussions significatives sur les indicateurs macroéconomiques utilisés pour apprécier la soutenabilité budgétaire et la trajectoire économique du pays.
Selon la nouvelle base, le PIB du Sénégal pour l’année 2021 s’établit désormais à 17 316 milliards FCFA, contre 15 261 milliards FCFA dans la base 2014, soit une revalorisation de 13,5 %, équivalant à plus de 2 054 milliards FCFA de richesse additionnelle. Ce relèvement provient principalement d’une meilleure couverture statistique de l’activité économique, en particulier grâce à de nouvelles enquêtes dans les secteurs informels et la mise à jour de nombreuses sources administratives. L’amélioration de la valeur ajoutée globale atteint ainsi 15,2 %. Les nouvelles enquêtes, dont l’EHCVM II sur les conditions de vie des ménages, l’enquête sur le transport informel, les opérations dans l’élevage, et l’étude sur les marges commerciales et de transport, expliquent à elles seules plus de 11 points de la révision. En parallèle, la mise à jour des sources courantes et des classifications ajoute trois points supplémentaires. Les ajouts méthodologiques ont, quant à eux, un impact légèrement négatif, mais n’annulent pas la tendance globale d’élargissement de la base productive.
Cette révision modifie sensiblement la lecture de la structure de l’économie sénégalaise. Le secteur tertiaire, déjà dominant, renforce son poids et représente désormais 53,4 % du PIB, confirmant le rôle central des services et de la distribution dans le dynamisme économique. Le secteur secondaire recule à 22,6 %, reflétant les limites persistantes de l’industrialisation, tandis que le secteur primaire se maintient autour de 15,4 %, en léger repli. Ces ajustements révèlent également une contribution beaucoup plus importante du secteur informel avec la valeur ajoutée des ménages, en particulier dans les activités non structurées, enregistre une progression de 24,2 %. Les institutions sans but lucratif au service des ménages se distinguent par une hausse spectaculaire de leur valeur ajoutée, qui bondit de plus de 250 %, soulignant une meilleure prise en compte statistique de leur activité.
La révision du PIB a un effet mécanique sur plusieurs indicateurs de convergence utilisés par l’UEMOA et la CEDEAO. Le ratio d’endettement public, qui s’élevait à 90,8 % du PIB dans l’ancienne base, ressort désormais à 80,0 %, une baisse de plus de dix points qui allège, sur le papier, la pression sur la dette et améliore la perception de la trajectoire budgétaire du pays. Le déficit budgétaire global, rapporté au PIB, passe de -13,3 % à -11,8 %, tandis que le taux de pression fiscale recule de 18,0 % à 15,9 %, en raison du relèvement du dénominateur plutôt que d’une baisse des recettes. Le solde extérieur courant s’améliore également, passant de -12,1 % à -10,7 % du PIB.
Cette situation se complète avec un contexte de réelles difficultés du gouvernement sénégalais à convaincre les institutions internationales de lui accorder leur confiance à travers un programme du FMI, dues aux discours politiques panafricanistes et souverainistes ambigus qui ont créé un doute sur l’orientation et la vision du gouvernement actuel d’Ousmane Sonko.
Au-delà des chiffres, cette actualisation modifie profondément la manière dont les investisseurs, partenaires techniques et financiers, institutions de développement et bailleurs internationaux évaluent l’économie sénégalaise. Les nouvelles données offrent une image plus précise des capacités productives, des équilibres macroéconomiques et du poids réel de chaque secteur. Pour un pays en pleine exploitation pétro-gazière, cette clarification statistique constitue un élément majeur pour renforcer la crédibilité macroéconomique, ajuster les politiques publiques et faciliter la prise de décision des acteurs économiques. Elle dèmontre les défis persistants sur le poids excessif du secteur informel, la faiblesse relative de l’industrie, la dépendance élevée aux services, la vulnérabilité extérieure et la nécessité de renforcer la fiscalité.
Face aux marges budgétaires qui se resserrent, les besoins de financement qui augmentent, et la mobilisation des recettes qui reste insuffisante pour suivre le rythme des dépenses, en particulier dans un contexte où le taux de pression fiscale demeure bas malgré la révision du PIB. S’y ajoute une détérioration du climat extérieur, marquée par un déficit courant encore élevé, signe de la dépendance structurelle aux importations de biens essentiels.
Enfin, l’économie peine à absorber l’attente créée autour de l’exploitation pétro-gazière, dont les retombées immédiates sont plus limitées que prévu, tandis que les secteurs porteurs de transformation structurelle n’enregistrent pas d’avancées majeures. L’image d’une économie plus grande ne doit donc pas masquer le ralentissement de sa dynamique, les déséquilibres persistants et le besoin urgent d’une expertise authentique et d’un leadership èclairè pour sauver le Sènègal, qui s’impose. Zaynab Sangarè