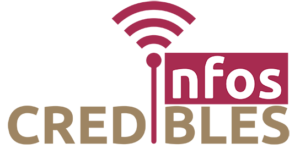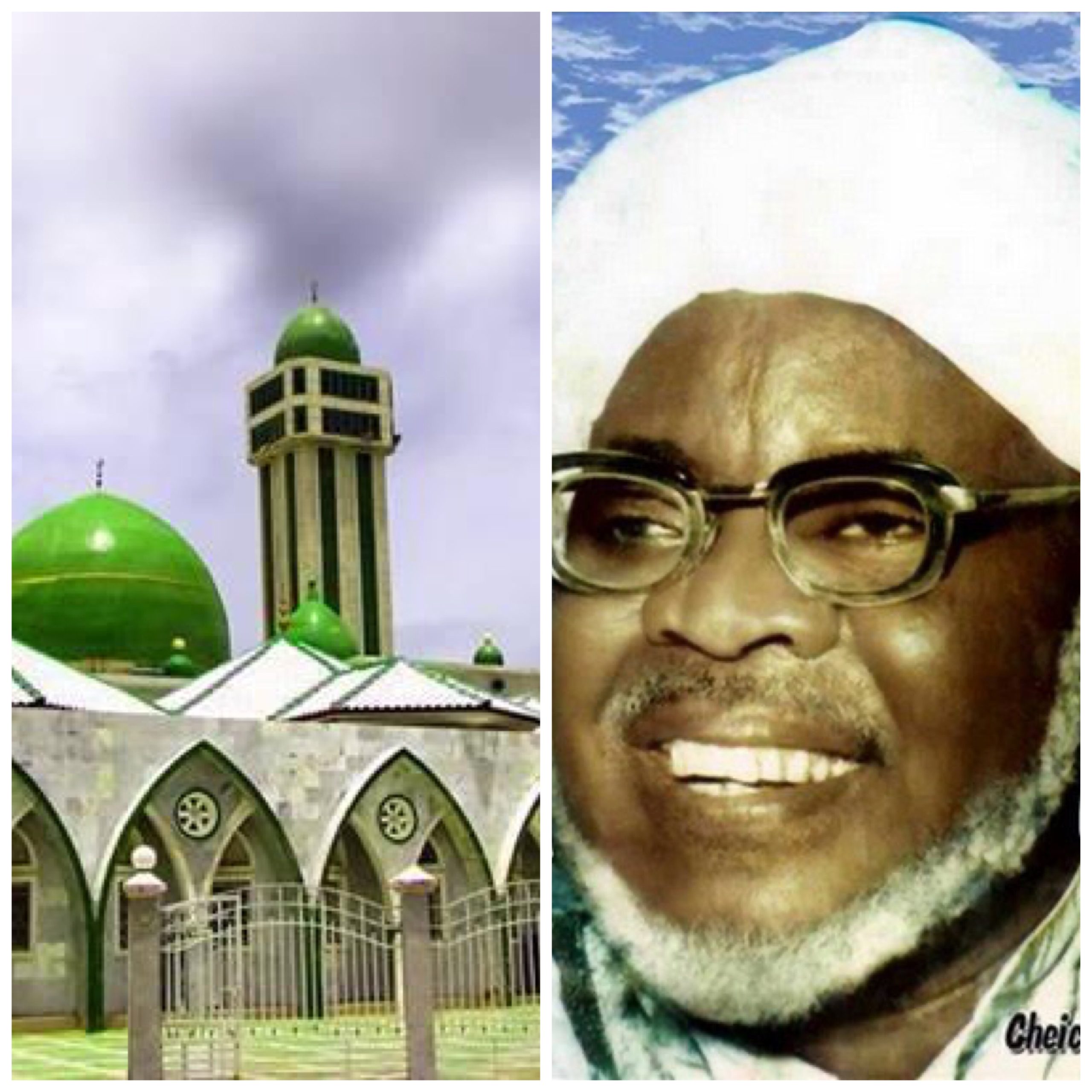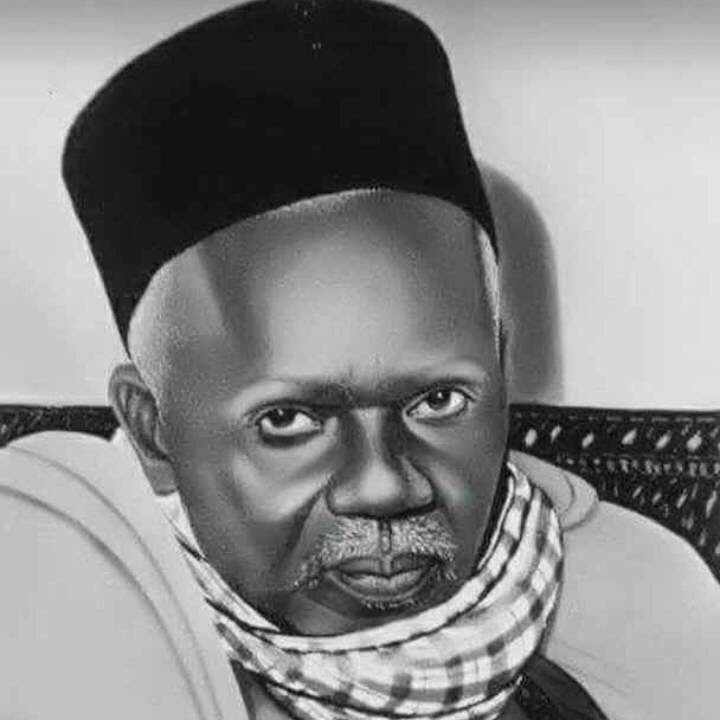L’Afrique tente de contenir une vague de choléra qui grossit de semaine en semaine. Dans les centres de soins de Kinshasa, de Juba ou de Khartoum, les mêmes images se répètent, des files d’attente interminables, des soignants débordés, des lits trop rares et l’inquiétude qui se lit dans le regard des familles. Les Centres africains de contrôle des maladies recensent désormais plus de 300 000 cas en 2025, un niveau trois fois supérieur à celui de 2022.
La maladie ne surprend pas les spécialistes. Elle prospère là où les infrastructures n’arrivent plus à suivre la croissance des villes, là où l’eau potable se fait rare, là où les conflits interdisent la réparation des réseaux sanitaires. Derrière chaque statistique, il y a un contexte avec un quartier privé d’eau courante à Lagos, un village congolais dont les puits ont été contaminés après des inondations, des camps de déplacés où l’hygiène se dégrade chaque jour davantage. Dans certains pays, comme la RDC, l’Angola, le Nigeria, le Soudan ou le Soudan du Sud, les équipes médicales parlent d’un combat quotidien contre une maladie qui se répand plus vite que les solutions disponibles.
Face à cette flambée, les autorités sanitaires appellent à une réponse coordonnée, durable et surtout structurante. L’urgence n’est pas seulement médicale, elle est politique, économique et sociale. L’Afrique a déjà connu des épisodes de choléra, mais rarement avec une telle intensité. Et si la période actuelle marque un tournant, ce n’est pas seulement en raison du nombre de cas, c’est parce qu’elle révèle les failles profondes et persistantes des systèmes d’eau et d’assainissement du continent. Tant que ces infrastructures ne seront pas consolidées, le choléra continuera de frapper, saison après saison. Zaynab Sangare