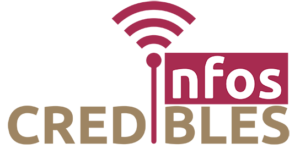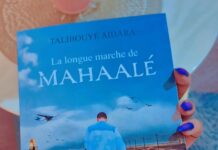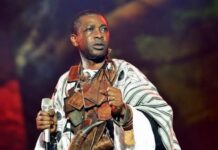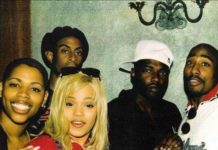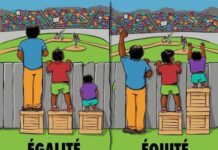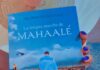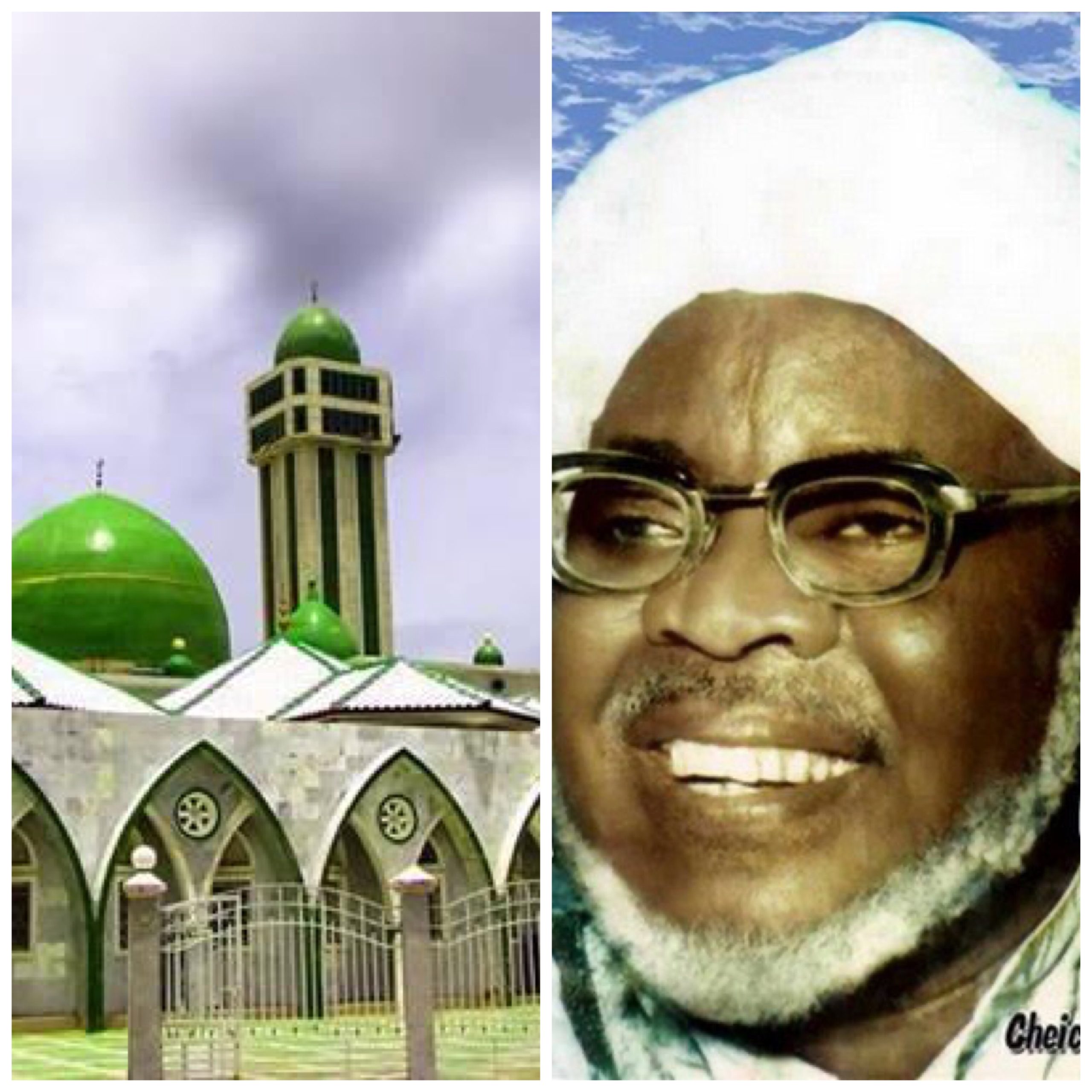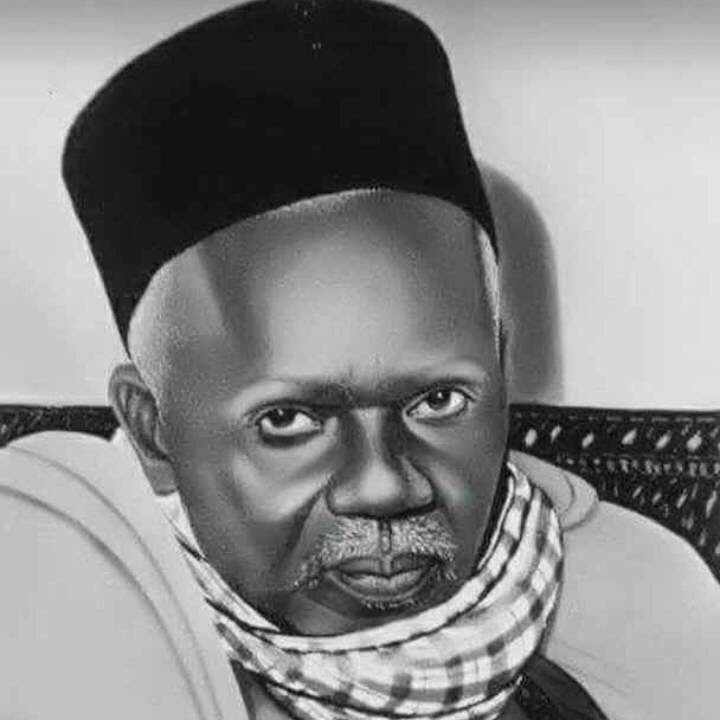Après deux années de hausse spectaculaire, les prix de l’huile d’olive amorcent un recul sur les marchés internationaux. Cette tendance, favorable aux consommateurs, soulage les budgets des ménages mais soulève des préoccupations économiques majeures dans les pays du Maghreb, où l’oléiculture joue un rôle central dans l’agriculture, les exportations et le développement rural.
Les cours, qui avaient dépassé les 9 000 euros la tonne en 2023-2024, sont redescendus progressivement autour de 5 000 à 6 000 euros, en fonction de la qualité des huiles. Ce repli s’explique par plusieurs facteurs : des conditions climatiques plus favorables dans le bassin méditerranéen ont permis une meilleure récolte pour la campagne 2024-2025, les stocks mondiaux sont en voie de reconstitution et la demande s’est ajustée face à des prix devenus difficilement soutenables pour de nombreux marchés.
Pour les pays du Maghreb, cette correction du marché représente un tournant. La Tunisie, le Maroc et l’Algérie, chacun à un stade différent de développement de leur filière oléicole, doivent désormais adapter leurs stratégies face à un environnement moins favorable.
En Tunisie, la baisse des prix intervient après une période de recettes exceptionnelles. Deuxième exportateur mondial, le pays avait tiré parti de la flambée des cours pour générer des revenus record, dépassant les trois milliards de dinars en 2023. Ces gains avaient permis de soutenir la balance commerciale et d’apporter un appui crucial aux régions rurales, où l’oléiculture fait vivre près d’un cinquième de la population agricole active. La contraction des prix fragilise désormais ces équilibres. Les petits producteurs, souvent regroupés en exploitations familiales, voient leurs marges s’éroder. Cette pression pourrait cependant accélérer une mutation déjà amorcée du secteur, avec un recentrage sur la qualité, l’irrigation maîtrisée, et le développement de labels biologiques ou d’appellations d’origine, où les marges demeurent plus stables.
Au Maroc, l’État s’est engagé dans un vaste programme de plantation visant à étendre la surface oléicole de 250 000 hectares supplémentaires à l’horizon 2030. Ce plan, intégré aux stratégies agricoles nationales, reposait en partie sur des hypothèses de prix élevés pour garantir la rentabilité des nouvelles plantations. La baisse actuelle des cours oblige les coopératives et les producteurs à réévaluer leurs modèles économiques. L’accent est désormais mis sur la transformation locale, avec un effort accru pour développer des marques nationales, valoriser l’embouteillage à la source et conquérir de nouveaux marchés, notamment en Afrique subsaharienne, où le Maroc dispose d’avantages logistiques notables.
En Algérie, le contexte est différent. Le pays, traditionnellement importateur d’huile d’olive, a lancé ces dernières années un programme de développement visant à réduire sa dépendance extérieure. La baisse des prix internationaux représente un avantage immédiat pour les consommateurs, mais elle interroge la viabilité économique des investissements en cours dans la filière locale. L’État maintient néanmoins sa stratégie, en insistant sur le rôle de l’oléiculture dans la diversification de l’économie, au-delà des hydrocarbures, et dans l’aménagement des zones rurales, en particulier les régions montagneuses. Des mécanismes de soutien public, tels que la protection douanière et les subventions à la production, permettent de compenser partiellement le manque de compétitivité, sans toutefois lever les incertitudes sur la durabilité du modèle.
Dans l’ensemble du Maghreb, cette évolution des prix de l’huile d’olive agit comme un révélateur des fragilités structurelles et des choix stratégiques à consolider. Si elle offre une respiration aux marchés de consommation, elle contraint les producteurs et les décideurs à repenser les équilibres économiques de leurs filières oléicoles, entre soutien aux petits exploitants, montée en gamme et ouverture à de nouveaux débouchés. Avec Zainab Mussa de Afrikcom